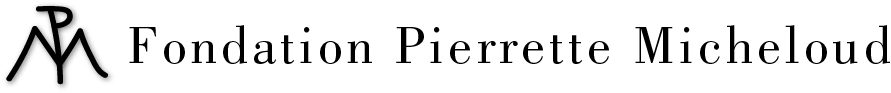Etre au monde – sans peur ni honte, sans hâte, et sans calcul
(sur la présence des poètes, aujourd’hui)
«La vérité n’est pas relative; par sa nature même, elle est
à la portée de tous, elle est simple et évidente – souvent
même, d’une façon qui fait mal.»
Simon Leys
Pas de quoi fanfaronner, mesdames, messieurs, chers amis – et je ne veux pas dire que je ne serais pas heureux de ce Grand Prix que je reçois si généreusement, en ce jour de novembre, après René de Obaldia, Yves Bonnefoy, et Marc Alyn, des poètes de haut rang, mais je songe à la situation de la poésie, ici, en Europe, dans le monde occidental, et je voudrais en dire un mot – une façon pour moi de vous remercier – en particulier, chacun des membres de la Fondation.
J’aimerais d’interroger l’espèce de mépris qui accompagne la poésie de nos jours, cette ironie gentillette chez tant de nos contemporains qui dissimule une indifférence quasi totale, et c’est naturel, une sérénité de bovins à l’engrais, égaillés dans les pâtures…
Cependant la chose est sérieuse, je dois faire gaffe, comme on dit allègrement, sinon les anges (1) avec lesquels Pierrette Micheloud se trouve à table pourraient, aujourd’hui même, venir me fustiger, déjà qu’ils ne comprennent pas très bien ce que je fabrique ici, moi qui ne connaissais pas leur interlocutrice il y a seulement quelques semaines, et moins encore qu’elle eût été poète durant son passage sur cette terre.
Aussi est-il hors de question d’échanger de la paille contre le grain que cette curieuse personne a versé dans ma sacoche, certes non!
Et puis, d’elle, cette image que je veux retenir, maintenant que j’en sais un peu plus: une rimeuse sur les routes de son Valais natal, une vagabonde émérite et digne, porteuse de la parole saphique (2) de village en village; ainsi, restée fidèle à l’unique vocation d’un poète, qui est de réveiller «ceux qui n’entendent pas le feu de la flûte… et qui sont pareils aux morts…», selon Djalâl ud-Dîn Rûmi,(3) le poète persan du treizième siècle.
*
J’en viens à mon propos – trop sévère, sans doute, vous l’excuserez, vous le corrigerez au besoin.
Quand la parole ordinaire de nos vies ordinaires subit un tel châtiment, dévaluée qu’elle est, si souvent inepte, inapte à la vérité en tous les cas, voire, lui étant franchement hostile, nous enfermant dans un rapport à l’Image, une sorte de tautologie permanente, et les pieux mensonges, favorisant les menées hypocrites, un radotage coloré, la parole de poésie, elle, nous reviendrait d’un au-delà du Temps, dans la mesure où elle articule le passé et l’avenir dans chacune de ses manifestations, entendez ici le poème, et mieux, le livre de poésie, une architecture.
La fidélité à cette parole est pour le poète une lampe, et celle-ci va brûler jusqu’à la fin, elle représente son destin qui ne saurait être un destin vicaire.
Elle se situe, cette parole – comme chacun de nos instants, décisifs, car nous savons qu’ils nous sont comptés – en ce présent mystérieux qui sans cesse nous échappe, elle naît de ce long regard qui déborde le temps de l’immédiateté fonctionnelle auquel nous nous soumettons la plupart des heures, elle naît des souffles de l’origine, elle en a la force, le trouble, l’impénétrable, l’inachevable, et, c’est un paradoxe, l’évanescence… Rien d’essentiel sinon cette loi de la fragilité de l’être et, selon la pire de nos expériences, l’absence, la disparition des êtres que nous aimons, que nous avons aimés.
Dans cette perspective, à ce jour, cette parole a participé à une transmission universelle, je veux parler de ce glissement subtil d’une génération à l’autre, une réalité en soi très émouvante, si nous la reculons jusqu’au fond des millénaires, non pas à titre de bagage culturel, (ah! le foutoir que l’on nomme «culture» dans les médias!), pas du tout, mais sous le signe de la parole vivante qui sauve l’humanité en nous, du moins ce qu’il en reste, et ce qui doit continuer d’être transmis: la soif de l’amour, et sa guérison, la grâce de l’amitié, le bien-fondé de la compassion, de la bonté, toutes choses qui ne trouvent leur force que dans des actes; le sens de la gratuité, quand tout ce que nous recevons d’essentiel reste secret; et, enfin, s’il est possible, le sens de la beauté… cet émerveillement devant la terre à découvert, la terre malmenée, si menacée, nous la contemplons désormais depuis l’espace (une fois relevés ses voiles détachés, dirait Jean Racine), et nous mesurons mieux ses fragiles équilibres.
*
J’ai construit mon œuvre, en ses pudiques commencements, avec la volonté d’écouter le silence d’après-guerre – le silence né dans le camp d’extermination – après que les Juifs européens eurent été massacrés par les nazis dans un monde proche de l’indifférence, et les témoins de ce silence au fil des années, ceux qui ne refusaient pas de s’y confronter. C’est à ce silence de l’holocauste que j’ai voulu que le poème fît écho, pour en recueillir quelque chose en somme, le capter serait trop dire, l’écouter simplement s’égoutter en cette fontaine de Non-sens qui, là, débordait – nous ne l’appelions pas encore d’un nom juif: shoah.(4)
Et c’est encore un poète juif, mais russe celui-ci, Ossip Mandelstam, qui m’a redonné confiance, et la force d’écrire des poèmes, quand j’eus atteint mes trente ans. J’étais en quête d’un chemin, d’un sentier peut-être – comme un autre le fut d’un rendez-vous dans la montagne (5) – afin de revenir dans l’humanité la plus ordinaire, de m’assurer, ou de me rassurer, grâce à cette «quelconquerie» – précieuse en fait – que j’avais connue chez les miens, en Ajoie, dans le Jura, sur la façade Est de L’Hexagone, moi, poète frontalier.
Les vies les plus quelconques, anonymes en quelque sorte, sont d’une si grande intensité qu’elles nous subjuguent – ce que redécouvrirait plus tard à sa manière, tellement supérieure, Pierre Michon dans ses Vies minuscules. (6)
*
Par ailleurs, c’était aussi vouloir prolonger l’incessant et très pur travail des poètes du monde entier, et les plus proches, je veux citer René Char en premier, et très vite, le plus amical, Pierre Chappuis, dès que je l’eus rencontré une première fois; Philippe Jaccottet ensuite (qui fut mon premier lecteur, présent – avec Pierre-Alain Tâche, Florian Rodari, Frédéric Wandelère, lorsqu’il fallut passer cette douane des premiers livres…); c’était méditer la relation qui unit Mandelstam à Paul Celan, fréquenter d’autres poètes, me nourrir de leur parole, faire quelques progrès dans l’art du dialogue, et l’exercice du contrepoint, avec Gerard Manley Hopkins, Umberto Saba, Eugenio Montale, Emily Dickinson, Georges Schéhadé, Johannes Bobrowski, beaucoup d’autres, qui me sont chers à divers titres. Ne serait-ce que ce jurassien de Champagne pouilleuse, Jean Grosjean, lui, le vivant qui s’avance vers nous avec la joyeuse insolence d’un iconoclaste.
La poésie était ainsi vécue comme un appel permanent, et la réponse à un appel; une manière aussi d’interjeter appel, en deux mots d’en appeler à l’humanité en nous sans cesse en danger de se perdre: en notre fond individuel d’abord; dans les habitudes ensuite, et les facilités, et le deuil de la pensée, et les mœurs improbables, et les dérives, les folies auxquels cèdent trop volontiers les hommes malgré la conscience du mal qui devrait les habiter. Et nous, en Europe!
La poésie est donc un appel exigeant, sans concession, à ne pas déchoir, et son propos est toujours politique par quelque manière, je le crois; son exigence de probité, et pas moins sa rigueur formelle, l’aident dans son refus de céder à la complaisance et aux futilités. Sa dimension est par nature essentiellement éthique. Sont en jeu: le souci du monde, au sens où l’a pensé Hannah Arendt, et le rapport à la langue. Eh oui! l’un de ses objets: redresser la barre de la langue, ce vaisseau si menacé de se défaire, d’être remplacé par une sous-langue de robots, sans corps et sans entrailles. Et surtout sans pitié.
Et je ne parle pas du charme des parlures populaires, aujourd’hui disparues. O merveilleux accents de Belleville (7) de Ménilmontant, des Batignolles, où êtes-vous passés? En Suisse, nous le savons, les traits dialectaux, du moins, en préservent quelques couleurs…
*
Quelle fragilité, l’entreprise poétique! Bien pauvres ses outils en regard de ceux de la technique omniprésente! «Ne rien créer.», dit Jean Grosjean, «Seulement détecter les connivences entre le mot et l’être.»(8) Quelques signes sur la page font bouger d’un coup notre esprit, ou s’ils ne viennent pas percer notre cœur?
Une pesée de syllabes, un battement de consonnes, l’éclairage des voyelles, sans oublier, dans notre langue, la merveille du «e» muet qui est comme la réserve d’eau que les caravaniers emportent avec eux en leur désert, ai-je écrit quelque part. Et voilà pourquoi la poésie mérite la mort… elle y est vouée dans le monde tel qu’il va, une mort sous la forme de l’oubli, du brouillage, de l’anonymat, de l’ensevelissement, de l’écrasement sous le poids des vanités. Car nos sociétés se contentent d’étaler un vide sidéral qui, j’en ai peur, les constitue. Qu’est-ce qui aurait changé depuis Babylone? Les sociétés, ces grandes machineries anonymes et aveugles, sont et restent notre épreuve à chacun.
*
Mais ne pas appeler poésie ce qui n’a rien à voir avec la poésie! La grande poésie, outre qu’elle entraîne le souvenir du Souffle et de la Parole à l’origine de tous les univers possibles, est le toucher miraculeux des mots; c’est un don immérité, invraisemblable, destinal… une façon d’atteindre le point aveugle du langage, un tremblement.
Et les pensées les plus hautes, les sentiments les plus purs, les intentions les plus limpides, les intellections les plus hardies, n’y sont jamais convoqués sans l’humble service de chaque vocable à l’intérieur du souffle du poète, et de sa voix, unique. Alors les roues dentées du mythe et du symbole retrouvent leurs nécessaires engrenages comme leur urgence, redéployant le sens du monde le plus lointain, le plus secret, et ni le savon, ni la crevette, ni même le mimosa (9) ne déterminent l’horizon du réel, aucun de ces objets ne prétend servir d’ultimes recours à la morale en ruine après les deux Guerres mondiales.
Elle serait, la poésie dont je parle, une manière de retourner la peau du Temps, de percevoir quelque chose de l’envers du décor, c’est-à-dire de goûter les impatiences de l’âme, et de lire les nœuds que noue le tapis du destin, à son envers – le dessin lui-même, en son endroit, étant réservé, jusqu’à l’heure du Jugement ; car nous sommes les contemporains du dernier Jour à l’instant de notre mort puisque se déchire d’un coup la bannière de l’espace/temps…
Elle est le fruit des renoncements, l’issue splendide d’une vertu froide; et, selon Cristina Campo (10): «…la patiente accumulation de temps et de secret qui soudain se renverse en ce miracle d’énergie supérieure; le précipité poétique.»
On y trouverait comme l’indiquait Philippe Jaccottet à propos, justement, de l’œuvre de Mandelstam, qu’il découvrait, je le cite, de tels accords «… de sonorités, de pensées, d’images, de sons, de sentiments, de sensations, si merveilleusement combinés qu’ils attestent, contre les conditions les pires qu’il peut y avoir pour l’homme, une espèce d’ordre, caché, d’ordre secret du monde…» ; «… et si la poésie n’est pas cela, ajoutait-il, ça ne vaut peut-être plus la peine d’en parler.» (11)
*
Voilà, brièvement dit, ce qui justifie ma pensée: inutile de se plaindre, mais pas de quoi pavoiser, quand l’humanité d’aujourd’hui semble vaciller sur les échasses qu’elle s’est taillées elle-même, et qui menacent de se briser.
Dans cet état de manque, et cette ambiance de braderie – tandis que les renards squattent l’antre des lions, (12) qu’ils y sont toute aise, et pas peu fiers avec ça – il nous revient de lire les poètes; faisons-leur, voulez-vous, l’aumône de notre existence d’êtres parlants, de lecteurs, d’amis: ils sont là, ils ne se sont pas éclipsés, ils tiennent les marges, les ailes du champ de bataille, par impossible; ils trouvent encore des éditeurs, quelques soutiens, des prix existent – et le vôtre, grand merci; leurs paroles circulent, même au compte-gouttes, sur les réseaux médiatisés, bref, ils maintiennent au monde, vaille que vaille, selon le mot d’André Frénaud, (13) leur «inhabileté fatale». Puissent-ils, les poètes, ne pas se tromper de rôles, et demeurer sans peur, ni honte, ni hâte ni calcul, fièrement, dans ce monde, les ânes et les ânesses porte-reliques de la Parole… les humbles serviteurs et servantes du Souffle pur.
Il est certain que l’humanité elle-même, au retour de ses rêves de puissance, sortie de sa distraction – assez féroce il est vrai, en aura besoin.
Merci de votre écoute.
Pierre Voélin
Notes:
(1) Allusion à peine retenue au célèbre film de Jane Campion, Un ange à ma table, 1990 – un film qui rend justice aux divers textes autobiographiques laissés par la grande poétesse néo-zélandaise: Janet Frame.
(2) Allusion à Sappho (Mytilènes, Lesbos, vers VIIe – VIe s.), créatrice du lyrisme érotique dans la poésie universelle; elle célèbre la grâce et la beauté féminines avec des accents à la fois tendres et ardents.
De Sappho, Johannes Bobrowski écrit dans un poème tiré de Im Windgesträuch, Dans les buissons du vent, 1970:
Sappho, Freundin, Traüme des Mädechen deine
Lieder: goldne Nägel im Bogentore
dieser Nacht, die dein war und die unsre
ist und unendlich.
Sappho, amie, ces rêves de jeunes filles
tes chants: clous d’or dans le portail voûté
de cette nuit, qui fut tienne et qui est
nôtre et à l’infini.
(3) Maulana Djalâl un-Dîn Rûmi, poète mystique persan, mort en Turquie en 1273; exilé dans ce pays, il y fonde l’Ordre des «derviches tourneurs», une vision mystique au cœur de l’Islam, souvent refusée, objet de persécution au long des siècles, y compris de nos jours.
(4) C’est le film de Claude Lanzmann: Shoah, 1995, qui, dans l’espace francophone, va très vite remplacer le mot Holocauste et imposer partout, à juste titre, cette désignation; le mot signifie «destruction totale, catastrophe absolue», alors que le mot holocauste renvoie aux sacrifices – qu’ils plaisent ou non à Dieu!
(5) Allusion tout juste voilée à l’une des plus belles méditations du poète juif Paul Celan, s’exprimant dans la langue des persécuteurs, l’allemand, dont il représente aujourd’hui l’un des plus grands poètes: «Dialogue dans la montagne», Die Neue Rundschau, Berlin, 1960.
(6) Pierre Michon, Vies minuscules, Gallimard, Paris, 1994 ; sans aucun doute, l’une des très belles fictions parues après la guerre dans la littérature française du vingtième siècle. Elle fut portée longuement, longuement élaborée, dans la douleur, par l’écrivain.
(7) Revoir, par exemple, les nombreux films français dans lesquels jouent Jean Gabin, ou Arletty ou Carette. Mais l’accent genevois de Michel Simon n’était pas mal non plus!
(8) Jean Grosjean, L’Art poétique, Editions Seghers, 1956; le texte est repris dans: Une voix, un regard, Paris, Gallimard, 2012: ce sont les textes retrouvés après la mort du poète, édités par Jacques Réda, préfacés par Jean-Marie Gustave Le Clézio.
(9) Cristina Campo, «La Flûte et le Tapis», dans Les Impardonnables, L’Arpenteur/Gallimard 1992.
(10) Allusion à la poétique de Francis Ponge – à sa volonté de redresser l’homme, de l’établir ou de le rétablir sur la base d’une morale, résolument matérialiste, en honorant la stricte réalité des objets du monde, en repartant du plus bas. Dans Pour un Malherbe, le poète traite Blaise Pascal de «planche pourrie», ce qui – même du seul point de vue de la liberté d’expression et de jugement – est assez croquignolet.
(11) Philippe Jaccottet, dans un «Entretien» à la télévision romande au cours de l’année 1975.
(12) Juste un souvenir du prince Giuseppe Tomasi di Lampedusa, dans Le Guépard, (1958); nous mesurons chaque jour ou presque, la parfaite lucidité de ce mage de la littérature italienne.
(13) Cette très belle expression, dans la bouche du poète, André Frénaud (1907-1993), qui est interrogé, en 1978, par Bernard Pingaud; cet entretien donnera lieu à un livre paru l’année suivante chez Gallimard avec ce titre éponyme: Notre inhabileté fatale